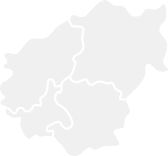« Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir » (Ecclésiaste 3, 1)
Publié le 05/10/2025L’entrée dans l’automne, la proximité de la fête de tous les saints connus ou inconnus, le 1er novembre, et la prière pour les défunts, le 2 novembre, nous invitent à réfléchir à cette parole de l’Ecclésiaste.
Des débats reviennent régulièrement sur ces grands moments de l’existence humaine : naître et mourir. Les sciences et outils de la médecine ayant progressé, les frontières deviennent plus ténues, plus délicates à appréhender. Or, le pape François attirait notre attention, dans l’encyclique Laudato Si (n°105) : « le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir1 », parce que l’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience. Chaque époque tend à développer peu d’auto-conscience de ses propres limites ».
Dès les premières lignes de la Bible, est affirmé que nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Toute parole sur la dignité humaine rappelée au fils des siècles, jusque dans des Déclarations politiques du XXe siècle, est un écho de cette affirmation première : dignité du corps, de l’âme et de l’esprit qui sont la personne humaine, expressions de l’amour de Dieu et signes (manifestation) de sa présence. Chacun est voulu et aimé de Dieu, de sa conception à sa mort naturelle.
Cette dignité nous met en relation avec Dieu et avec nos contemporains au sein de la fraternité humaine. Les débats qui se tiennent sur le fait de donner la vie ou la mort doivent prendre en compte l’importance de la fraternité humaine à laquelle nous appartenons, une fraternité appelée à se dire et à s’exercer dans ces moments capitaux de nos existences. Attention à la pente que prennent nos sociétés en faveur d’une autonomie absolutisée de chacun poussée jusqu’au refus de dépendre de la bienveillance d’autrui.
Les soins palliatifs sont une des expressions éminentes de la fraternité humaine : la souffrance physique, émotionnelle, psychologique ou spirituelle appelle une oreille qui écoute, une main qui rassure, un soin qui soulage … Ces gestes et soins « reconnaissent » la personne dans son unicité et sa dignité, jusqu’au bout. Ils peuvent « aider les patients et leurs proches à accepter la vulnérabilité, la fragilité et la finitude qui marquent la vie humaine en ce monde », remarquait le pape François2.
Une artiste, Claire Oppert, dans son magnifique livre, Le pansement Schubert (2020, Denoël), rapporte la manière dont le chant du violoncelle vient toucher, dans les profondeurs de leurs êtres, les personnes malades, âgées, démentes, comme les familles et les soignants. Ce chant apaise, stimule ou réconforte. Ce sont des rencontres à chaque fois uniques, comme chaque personne est unique.
La musique est force.
Tisseuse de sons et de silences,
Elle unifie le temps fragmenté,
Restaure la permanence de l’existence.
Elle convoque la saveur du présent,
Rejoint les profondeurs,
Les touche et les exalte.
Eprouvé d’une dynamique de vie dans le corps figé,
Retour d’une intensité,
Retrouvailles d’une fluidité. (p.120)
La musique est envol.
Elle respire les hauteurs.
Dans la lutte contre l’effondrement de soi,
Les sons côtoient les cimes du ciel.
Ils restaurent le sentiment d’identité,
Ils appellent à défier la peur de la mort.
Le moi s’affermit dans l’éclatant soleil de midi. (p.136)
Fr. Eric Bidot, ofm cap, évêque de Tulle
_______________________________________________________
1 Romano Guardini, La fin des temps modernes, Le Seuil, 1952, p.92.
2 Message aux participants du symposium international et interreligieux sur les soins palliatifs, au Canada, du 21 au 24 mai 2024.